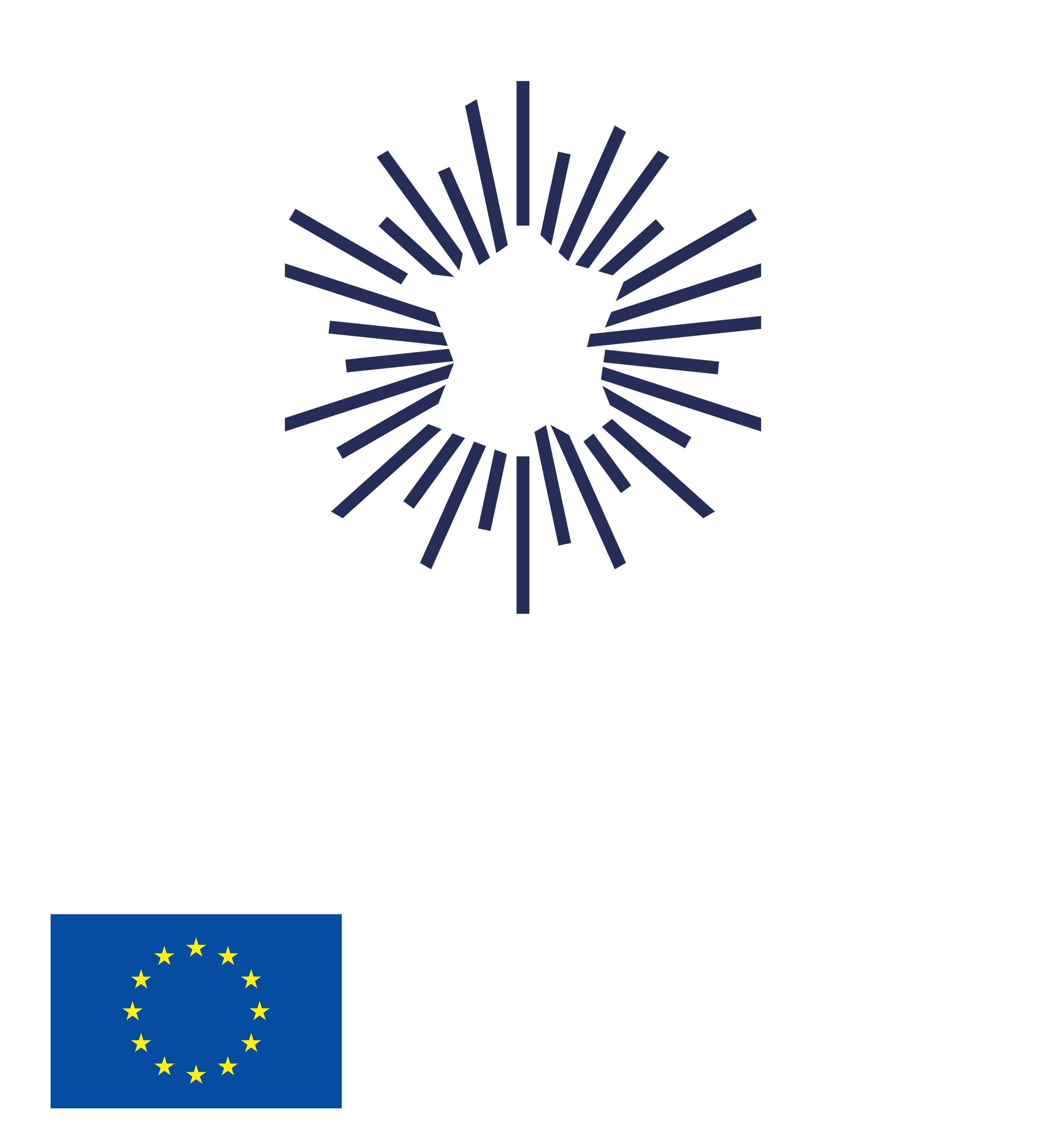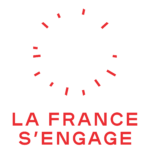WEBINAIRE – Sécuriser ses activités lucratives dans l’ESS : une exigence stratégique
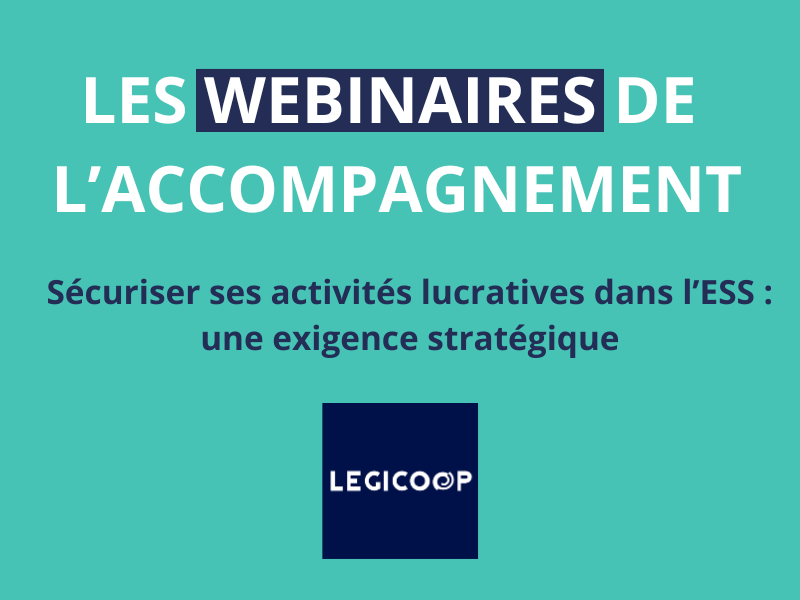
Alors que les modèles économiques des structures de l’ESS se complexifient, tiraillés entre impératifs de viabilité et exigences d’intérêt général, la question de la structuration des activités lucratives devient centrale. Comment préserver sa mission sans compromettre son équilibre ? Comment développer et diversifier ses ressources, notamment commerciales, sans dénaturer son projet ?
C’est à cette interrogation structurante qu’a répondu le webinaire animé par Maître Simon Chapuis-Breyton, avocat-associé chez Legicoop, à l’invitation de La France s’engage, qui propose régulièrement à ses lauréats et alumni des formations conçues comme des leviers de structuration pour les porteurs de projets.
Une clarification fondamentale : lucrativité juridique vs lucrativité fiscale
Simon Chapuis-Breyton a ouvert la session en posant les bases conceptuelles d’un débat souvent mal appréhendé: en droit fiscal français, la distinction entre lucrativité et non lucrativité ne repose pas uniquement sur le statut juridique mais aussi sur la manière dont l’activité est exercée.
Ainsi, une association, non lucrative par la forme, sur le plan juridique, peut être considérée fiscalement comme lucrative si ses activités présentent un caractère concurrentiel, si sa gestion n’est pas désintéressée ou si elle entretient des relations privilégiées avec des entreprises.
Ce double regard – juridique et fiscal – est essentiel pour comprendre pourquoi certaines structures, pourtant à but non lucratif dans leur forme, leur intention et leur gouvernance, peuvent être requalifiées et assujetties aux impôts commerciaux.
Les trois piliers de l’exonération des impôts commerciaux
Le cœur du propos a été structuré autour de la méthode appliquée par l’administration fiscale pour analyser la lucrativité fiscale des organismes sans but lucratif, méthode schématisée sous forme d’une pyramide par Légicoop.
Celle-ci repose sur trois étages fondamentaux :
➤ 1. La gestion désintéressée
Une condition sine qua non. L’association ne doit pas distribuer ses excédents, et son actif, directement ou indirectement, à ses membres. Les dirigeants ne doivent pas être rémunérés directement ou indirectement (sauf tolérance des ¾ du SMIC ou régime légal de rémunération des dirigeants avec seuils de recettes privées), et les dirigeants bénévoles doivent exercer un contrôle effectif et constant de l’association.
➤ 2. L’absence de relations privilégiées
C’est une zone grise et risquée. L’administration fiscale dans sa doctrine estime qu’une association doit être assujettie aux impôts commerciaux si elle entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel,
Est ainsi lucratif sur le plan fiscal un organisme qui permet de manière structurelle aux professionnels ou à des sociétés de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même.
➤ 3. Le caractère non concurrentiel des activités
La plus subtile à évaluer. Une activité est jugée concurrentielle si une entreprise fiscalisée exerce la même activité sur le même territoire.
Cependant, même dans ce cas, elle peut rester non lucrative si elle n’est pas exercée dans des conditions similaires à celles de l’entreprise concurrente . Cette évaluation s’effectue activité par activité, en croisant des critères de public, de tarification, de communication et de nature de la prestation ou du produit proposé sur le marché. C’est la fameuse règle dite des « 4P ».
Des outils concrets pour sécuriser les activités lucratives
Lorsque certaines activités entrent dans le champ de la lucrativité fiscale, plusieurs mécanismes permettent d’en encadrer la portée et les effets :
La franchise
En premier lieu, tant que les activités commerciales restent accessoires et que les activités non lucratives sont largement prépondérantes, une association peut bénéficier d’une franchise des impôts commerciaux jusqu’à 80 011€ de recettes commerciales par an.
La sectorisation
Quand les recettes commerciales dépassent le seuil de la franchise, une sectorisation comptable doit alors être mise en place. Elle permet d’assujettir aux impôts commerciaux uniquement les activités lucratives. Ce dispositif suppose de pouvoir mettre en place une comptabilité analytique rigoureuse, de façon à distinguer les activités lucratives et non lucratives, de suivre l’affectation des moyens à l’un ou l’autre secteur, et pouvoir notamment justifier de de la prépondérance des activités non lucratives (en temps passé, charges affectées, chiffre d’affaires, etc.).
La filialisation
Lorsque le rapport de prépondérance ne peut plus être respecté, ou lorsque l’association souhaite externaliser des activités commerciales, il est possible de les apporter à une filiale commerciale. On parle alors de structuration « hybride ». La filialisation permet de sanctuariser les activités non lucratives dans l’association-mère, tout en développant des prestations marchandes dans un cadre autonome au sein de la filiale.
Il importe alors de veiller à ce que les deux structures ne soient pas complémentaires commercialement, et en particulier que la filiale ne bénéficie pas d’avantages concurrentiels grâce à ses liens avec l’association-mère, ce qui entraînerait la qualification de relations privilégiées entre elles..
Le mécénat : une opportunité à manier avec prudence
Un point important a été consacré à l’éligibilité au régime fiscal du mécénat, souvent mal compris.
Être « d’intérêt général » au sens fiscal suppose, entre autres, d’exercer principalement une activité non lucrative s’inscrivant dans des catégories prévues par la loil’(à savoir social, éducatif, environnemental, culturel, etc.) (cf. articles 200 et 238 bis du Code général des impôts) et dont le périmètre est défini précisément par l’administration fiscale dans sa doctrine.
Demander un rescrit fiscal n’est ni obligatoire ni recommandé : en effet, la pratique permet de constater que l’administration fiscale tend à y répondre de manière très restrictive, en appliquant littéralement sa doctrine, souvent éloignée de la réalité des activités portées par les acteurs de l’intérêt général . .
La meilleure stratégie ? Un audit interne rigoureux si possible réalisé par un professionnel du droit qui permettra de sécuriser l’association et le mécène.
Sortir des incertitudes : la fiscalité comme outil de clarté stratégique
La maîtrise de sa structuration fiscale n’est pas un exercice secondaire ou défensif. Il s’agit d’un enjeu structurant pour le développement pérenne des projets d’intérêt général.
Mal encadrée, l’exercice d’activités lucratives peut remettre en cause le régime fiscal d’une association et la mettre en danger. . Bien structurée, elle devient un levier de changement d’échelle. Dans un contexte où la frontière entre le secteur lucratif et non lucratif tend à se brouiller, savoir qualifier ses activités, anticiper les évolutions de son modèle économique, et sécuriser sa structuration fiscale , devient une compétence stratégique.
En proposant régulièrement ces temps de formation, La France s’engage poursuit sa mission de renforcement des compétences au sein d’un écosystème d’acteurs engagés, tout en consolidant l’assise institutionnelle des projets qu’elle accompagne.