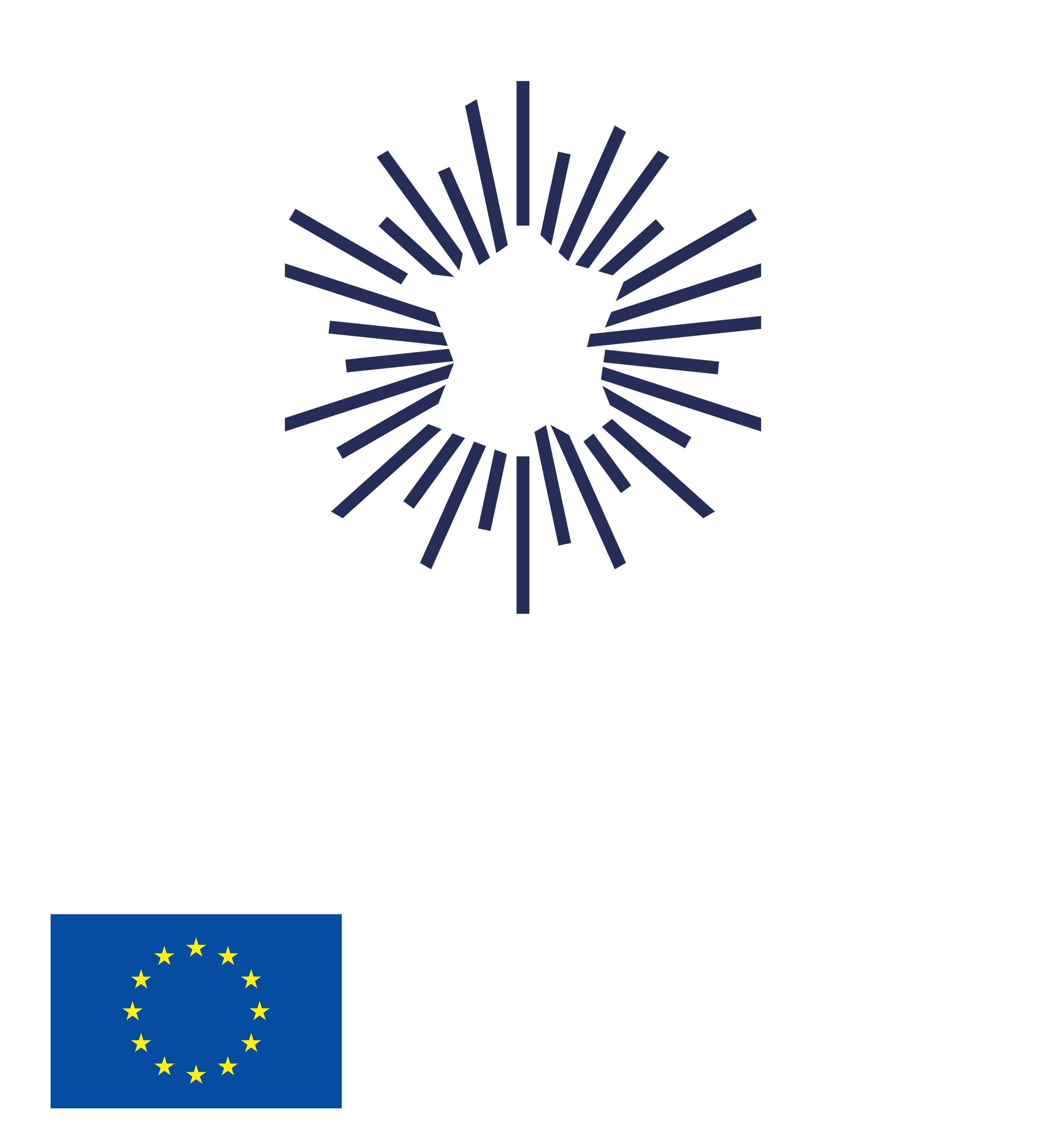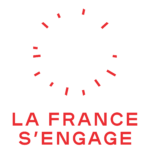WEBINAIRE – Sécuriser le cycle de vie d’un salarié dans l’ESS

Les structures de l’économie sociale et solidaire, animées par une forte culture du projet, placent souvent la finalité sociale au cœur de leur action. Pourtant, la vitalité d’un projet collectif repose aussi sur la solidité de son cadre juridique. Recruter, encadrer, accompagner et, parfois, se séparer d’un collaborateur requiert une maîtrise fine du droit du travail, sous peine d’exposer la structure à des risques importants : requalification, contentieux, redressement, ou perte de crédibilité institutionnelle.
C’est dans cette perspective que La France s’engage a proposé à ses lauréats et alumni un webinaire consacré au panorama des contrats de travail et au cycle de vie d’un salarié dans l’ESS, animé par Maître Stéphanie Daguerre, avocate associée chez Légicoop, cabinet dédié au droit des acteurs de l’économie sociale et des entreprises engagées et partenaire de l’accompagnement de La France s’engage.
Son intervention, précise et pédagogique, a permis d’identifier les points de vigilance essentiels à chaque étape de la relation de travail, de l’embauche à la rupture, en replaçant le droit du travail au service de la structuration et de la pérennité des projets.
Recruter dans l’ESS : rigueur et transparence
L’embauche est le premier acte juridique de la relation de travail. Elle engage durablement la structure et doit donc être menée avec méthode.
Maître Daguerre a rappelé que le choix du contrat (CDI, CDD, contrat de mission, contrat aidé, alternance…) ne peut être dicté par la seule opportunité de financement ou la temporalité du projet : il doit correspondre à la réalité du besoin et conforme aux cas de recours prévus par la loi. Un CDD sans motif précis ou insuffisamment justifié peut être requalifié en CDI.
La période d’essai doit également être encadrée : sa durée, son renouvellement éventuel, les modalités de rupture varient selon la convention collective et la catégorie professionnelle.
Autre point de vigilance : les frontières entre statuts. Le recours à des bénévoles, des volontaires en service civique ou des prestataires indépendants ne doit pas dissimuler une relation de subordination, critère central du contrat de travail. En cas de confusion, la requalification est encourue.
Dans un secteur où la mixité des statuts est fréquente, cette clarification est un impératif de sécurité juridique. Elle protège à la fois les salariés, les dirigeants et le projet.
Le contrat de travail : un instrument de clarté et de protection
Un contrat bien rédigé est le premier outil de prévention des litiges. Il traduit la réalité du lien de travail et anticipe les éventuelles zones de fragilité.
Maître Daguerre a insisté sur la nécessité d’une personnalisation minutieuse : un contrat type ou standardisé ne suffit jamais. Chaque poste doit être décrit précisément, en intégrant la mission, la durée du travail, la nature des tâches et les éventuelles spécificités du projet associatif.
Elle a également rappelé que le contrat comporte les principales clauses suivantes :
- la convention collective applicable, souvent celle de l’animation, ALISFA, du médico-social ou du sport, avec leurs clauses propres (rémunération, ancienneté, astreintes, etc.) ;
- les éléments de rémunération, notamment les avantages en nature ou les remboursements de frais ;
- intégrer, si nécessaire, des clauses spécifiques (mobilité, télétravail, non concurrence,…).
Un contrat de travail précis et complet protège autant l’employeur que le salarié : il permet de prévenir les incompréhensions et de garantir la loyauté de la relation de travail.
Enfin, elle a rappelé les obligations lors de l’embauche et la nécessité de tenir à jour les registres obligatoires (personnel, médecine du travail).
La fin du contrat : anticiper pour maîtriser
La rupture d’un contrat est toujours un moment sensible, humainement et juridiquement. Elle nécessite d’anticiper, de formaliser et de justifier chaque étape.
Les modalités de rupture sont variées : démission, licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD… chacune répond à un régime propre.
- La rupture conventionnelle impose un dialogue sincère et équilibré, formalisé par un entretien et une homologation par la DREETS. Tout vice de consentement (pression, précipitation) peut la rendre nulle.
- Le licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux : faute, insuffisance professionnelle ou motif économique. Les procédures sont strictes : convocation, entretien préalable, notification motivée.
- Les associations doivent identifier avec précision l’organe compétent pour décider de la rupture : président, bureau, conseil d’administration, selon les statuts. Une erreur dans cette chaîne de décision peut invalider la procédure.
Droit du travail et valeurs de l’ESS : une articulation nécessaire
Au-delà des aspects techniques, ce webinaire a montré que le droit du travail est un instrument d’équilibre entre rigueur juridique et cohérence éthique.
Les structures de l’ESS, parce qu’elles incarnent des valeurs de solidarité et de justice, se doivent d’être exemplaires dans la gestion de leurs équipes. Un cadre juridique clair n’est pas antinomique avec l’engagement : il en est le prolongement naturel.
Connaître et appliquer la loi, c’est garantir l’équité entre salariés, bénévoles et dirigeants, protéger les gouvernances associatives souvent composées de bénévoles non juristes, et préserver la confiance des financeurs publics et privés.
La professionnalisation du droit du travail dans l’ESS participe aussi d’une reconnaissance sectorielle : elle renforce la crédibilité des structures face aux partenaires institutionnels et favorise leur développement à long terme.
Professionnaliser pour durer
En proposant ces formations animées par des praticiens experts, La France s’engage contribue à renforcer la sécurité juridique et la maturité organisationnelle des projets qu’elle accompagne.
Ces temps de formation, loin d’être purement techniques, donnent aux structures de l’ESS les moyens d’une gouvernance solide et d’une gestion humaine conforme à leurs valeurs fondatrices.