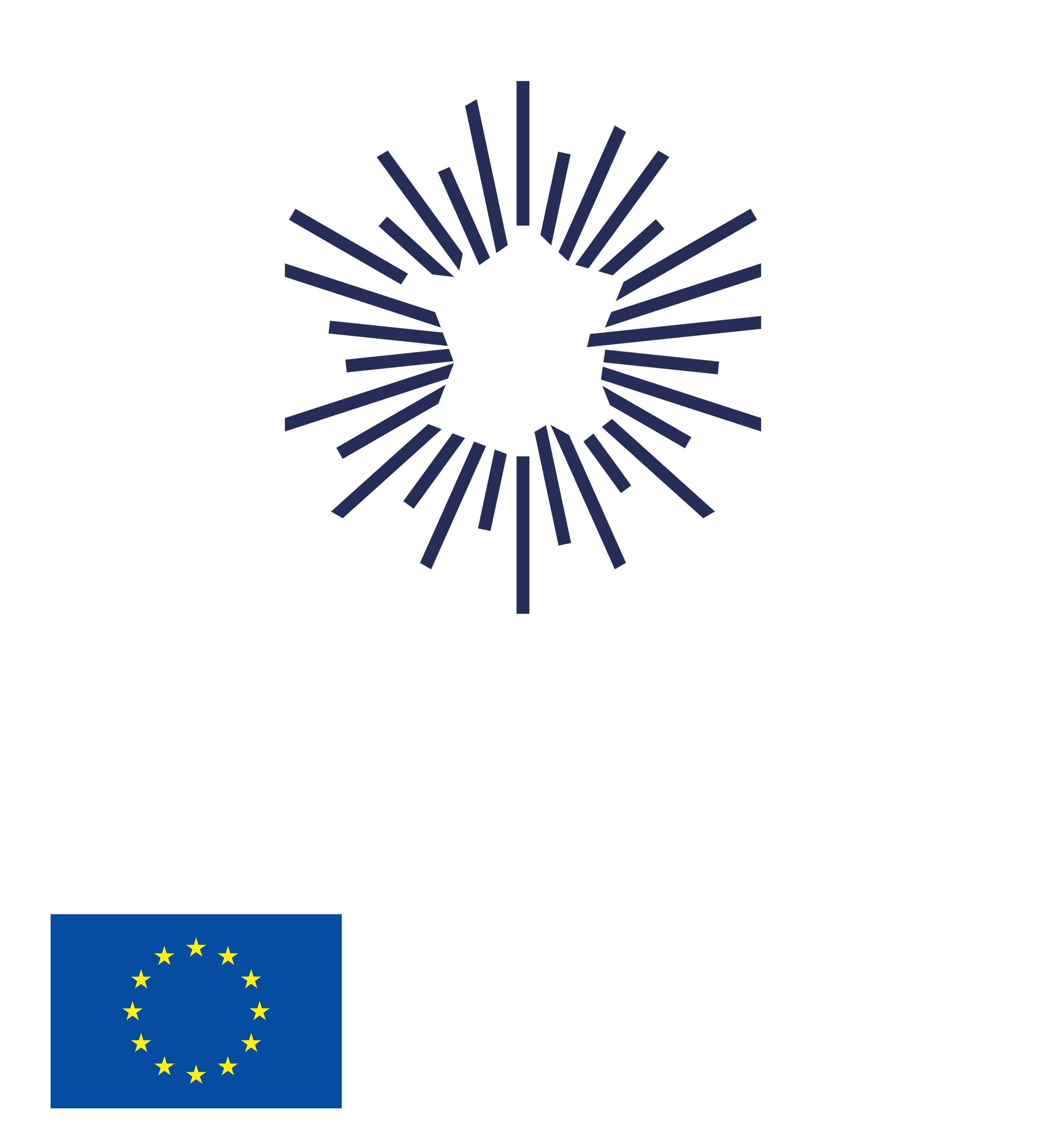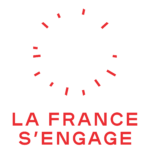Journée de l’Innovation sociale au Salon des Maires 2025

Cette journée était une première pour l’événement de référence de l’action locale, destinée à inspirer et outiller les élus à l’approche des municipales 2025.
Le 19 novembre 2025, l’Arène de l’Innovation du Salon des Maires et des Collectivités Locales s’est transformée en un laboratoire ouvert des politiques territoriales.
Pour la première fois, à l’initiative de La France s’engage et en partenariat avec le Salon qui en a fait un de ces temps forts, une journée complète était consacrée à l’innovation sociale, réunissant élus, praticiens de terrain, associations et acteurs économiques décidés à repenser l’action publique au plus près des besoins.
À l’approche des municipales de 2026, l’enjeu est déterminant : donner aux futurs exécutifs municipaux les outils, les méthodes et les alliés permettant d’inscrire l’innovation sociale dans la conduite quotidienne des politiques locales.
Cette journée a mis en lumière une conviction largement partagée : l’innovation sociale n’est plus un supplément ; elle devient une infrastructure essentielle pour les territoires, capable de répondre à la fois aux urgences sociales, à la transition écologique, aux fractures territoriales et aux aspirations nouvelles des habitants.
L’innovation sociale au service des collectivités locales
François Hollande, accompagné de Damien Baldin et d’Enora Hamon, a ouvert la journée en rappelant le sens politique de ce moment. L’ancien Président de la République et fondateur de La France s’engage a insisté sur le fait que les collectivités sont aujourd’hui “en première ligne“ face aux crises, et que l’innovation sociale constitue “un levier opérationnel, fiable et éprouvé pour inventer des réponses adaptées aux défis sociaux“.
Damien Baldin a insisté sur un point cardinal : les solutions existent, souvent déjà testées avec succès dans des communes rurales comme dans des grandes agglomérations. “Le rôle de La France s’engage est d’en permettre la circulation, de réduire les risques pour les élus, de sécuriser les partenariats“.
Enora Hamon a quant à elle situé cette journée dans une dynamique : “À l’heure où l’action publique doit accélérer, l’innovation sociale offre une méthode, une culture du faire et une capacité d’ajustement essentielle.”




Ruralités : quand un maire s’engage dans l’innovation sociale
Cette séquence a donné la parole à des acteurs qui vivent au quotidien ce que signifie revitaliser une ruralité trop souvent présentée sous le prisme du manque. Les échanges ont mis en tension deux représentations : celle d’une ruralité fragilisée, et celle, plus fidèle à la réalité, d’une ruralité inventive, structurante et profondément sociale.
Thibault Renaudin a retracé la genèse d’InSite, née lorsqu’il était maire d’un village confronté à l’érosion du lien social. Il a raconté comment, à l’époque, les habitants exprimaient autant une lassitude qu’un désir d’engagement : “Nos villages ne sont pas refermés sur eux-mêmes. Ils sont traversés par l’envie d’agir, par une capacité d’accueil immense et souvent sous-estimée.”
L’association a construit son modèle autour de cette intuition : accueillir des volontaires dans des villages, leur confier des projets enracinés et créer une dynamique intergénérationnelle.
Le témoignage du maire d’Aureille, Lionel Escoffier, a illustré la transformation à l’œuvre. Depuis 2020, la commune accueille des volontaires InSite. Ceux-ci ont permis de valoriser le patrimoine naturel, de dynamiser les jardins communaux, de créer un sentier pédagogique sur la biodiversité, et surtout de renouer des liens entre habitants :
“Ça a fait sortir les gens de chez eux. Cela a permis de fédérer autour de projets qui n’auraient jamais vu le jour. On a vu naître des rencontres improbables, des échanges entre générations, des initiatives spontanées.”
L’ancien volontaire Paul-Emmanuel Froment a apporté un éclairage précieux sur ce que représente l’engagement de six mois “au cœur d’un village” : formation civique, accompagnement, logement intégré et immersion totale dans la vie locale. “C’est une expérience qui change des vies pour toujours,” a-t-il confié, rappelant que ces missions sont aussi des tremplins professionnels.
Cette table ronde a démontré que la ruralité peut devenir un espace d’innovation sociale puissant, à condition que les collectivités acceptent de jouer un rôle de catalyseur, et que les porteurs d’initiatives soient accompagnés dans la durée.
Petite enfance – Construire un écosystème durable pour les 1000 premiers jours
Intervenants :
- Benjamin Cavalli, Directeur, Programme Malin (lauréat 2023)
- Julie Proffit, Marketing Manager, Laboratoire Gallia Blédilait (Danone Nutrition Spécialisée)
- Élisabeth Brun, Maire de Saint-M’Hervé (Ille-et-Vilaine), Conseillère déléguée à l’enfance et à la petite enfance à Vitré Communauté
Ici, les discussions ont montré comment un enjeu sanitaire et social majeur – les 1000 premiers jours de l’enfant – peut devenir un terrain de coopération actif entre collectivités, professionnels de la petite enfance, associations et entreprises.
Benjamin Cavalli a présenté la spécificité du Programme Malin : une structure hybride, cofondée par deux marques du groupe Danone pour répondre à un problème identifié dans de nombreuses études : les inégalités alimentaires dès la naissance. Le programme agit simultanément sur l’éducation à l’alimentation, la réduction des restes à charge, l’accès aux produits de qualité et la formation des professionnels.
Une étude inédite menée avec l’Inserm suit actuellement 600 enfants jusqu’en 2027 pour mesurer les effets à long terme des accompagnements.
Élisabeth Brun, qui mène l’expérimentation sur son territoire, a donné une image concrète de cette coopération. Elle a expliqué comment les services municipaux, les crèches, les assistantes maternelles et les acteurs locaux de l’alimentation ont été mobilisés pour créer un véritable « Village Malin ».
Elle a souligné un résultat immédiat : “Des familles ont appris à cuisiner des produits locaux qu’elles n’achetaient jamais. Les professionnels se sont approprié de nouveaux outils. Et des producteurs ont vu leur travail valorisé par un modèle qui ne les invisibilise plus.”
Julie Proffit a présenté l’apport de Danone dans cette dynamique, insistant sur la responsabilité d’une entreprise de grande taille : “Tout le monde connaît le Programme Malin en interne. Cela a fédéré nos équipes et permis de mobiliser d’autres entreprises.“
Elle a rappelé que l’objectif n’est pas philanthropique mais structurant : combler les inégalités de santé par des solutions pérennes.
Cette table ronde a mis en lumière un point essentiel : dans la petite enfance, aucune collectivité ne peut agir seule. Pour lutter contre les inégalités, c’est tout un territoire qui doit être mobilisé.
Les collectivités : comment renforcer un dialogue encore inégal entre associations et pouvoirs publics locaux ?
Intervenants :
- Sylvain Dumas, Co-directeur, Villages Vivants (lauréat 2019)
- Julien Guillaume, Maire de Montaigut-le-Blanc (Puy-de-Dôme)
- Marie Pochon, Députée de la Drôme
- Luc Thabourey, Directeur de la communication, France Active
Cette séquence a abordé une problématique qui touche particulièrement les communes de faible densité : la disparition des commerces et l’effondrement de l’immobilier commercial. Les interventions ont montré que la revitalisation des centralités rurales ne peut se limiter à des dispositifs classiques : elle implique un travail sur les usages, la gouvernance et le foncier.
Sylvain Dumas a dressé un tableau clair : la moitié des communes françaises n’ont plus aucun commerce. Cette déprise produit un cercle vicieux – moins de services, moins de sociabilité, baisse d’attractivité.
Villages Vivants intervient alors comme un “investisseur solidaire” qui achète, rénove, loue et accompagne des commerces portés par des collectifs d’habitants ou des acteurs de l’ESS.
“Nous accompagnons les initiatives qui recréent un cœur de village : des épiceries coopératives, des cafés associatifs, des ateliers partagés. Nous faisons en sorte qu’elles aient un lieu viable et durable.”
Julien Guillaume a décrit la démarche de Montaigut-le-Blanc, où la municipalité a choisi de ne pas reproduire les schémas habituels mais de partir des habitants. Après un diagnostic partagé, une épicerie participative a émergé avec 80 adhérents.
Le maire insiste : “Cela fonctionne quand l’élu accepte de lâcher le modèle classique de la commande publique. Notre épicerie ne correspond pas exactement au cahier des charges initial, mais elle fait bien plus : elle recrée du lien, de la culture, de la convivialité.”
France Active a rappelé l’importance de structurer ces projets en SCIC, pour que les habitants deviennent coproducteurs de leur dynamisme commercial.
Cette table ronde a montré que la revitalisation des centres-bourgs ne relève pas seulement d’un enjeu économique : c’est un choix stratégique de société, fondé sur les communs, l’implication citoyenne et la transformation du foncier.
Valoriser le patrimoine et inclusion sociale
Intervenants :
- Pâquerette Demotes-Mainard, Directrice générale, Acta Vista (lauréat 2016)
- Damien Baldin, Directeur général, La France s’engage
Cette séquence a exploré un angle souvent négligé : la capacité du patrimoine à devenir un outil d’insertion professionnelle. Acta Vista, association pionnière, a fait la démonstration qu’il est possible d’articuler restauration patrimoniale, montée en compétences et régénération sociale.
Pâquerette Demotes-Mainard a rappelé la portée mémorielle et symbolique du bâti ancien, mais aussi son potentiel d’avenir.
“Le patrimoine n’est pas seulement un héritage. C’est un support d’apprentissage et un vecteur de fierté. Il doit devenir un levier social.”
Elle a décrit le fonctionnement des chantiers d’insertion, où les personnes recrutées dans le bassin d’emploi acquièrent des savoir-faire rares (taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, restauration de voûtes, etc.). Ces compétences sont transférables dans des secteurs en tension.
Le chantier du Fort Saint-Nicolas à Marseille a été pris comme exemple : un lieu patrimonial d’exception devenu outil de réconciliation sociale.
Damien Baldin a insisté sur la capacité de ces modèles à offrir des réponses aux élus : valoriser le patrimoine tout en augmentant le pouvoir d’agir des habitants.
Il a rappelé que ces projets hybrident des financements publics-privés, tout en restant ancrés dans les besoins locaux.
Environnement : Produire l’énergie de son territoire par la coopération des habitants et des entreprises locales
Intervenants :
- Alexandra Lafont-Kaufmann, Responsable des réseaux régionaux, Énergie Partagée (lauréat 2022)
- Eugénie Ponthier, Adjointe au maire d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
- Gilles Wintrebert, Président, ÉnerCit’IF
Cette discussion a montré comment la transition écologique peut devenir un projet civique partagé, plutôt qu’un simple sujet d’infrastructures. Les projets citoyens d’énergie renouvelable misent sur l’implication directe d’habitants et d’entreprises locales.
Alexandra Lafont-Kaufmann a présenté la dynamique portée par Énergie Partagée : 425 projets accompagnés, une communauté de centaines d’acteurs et un objectif clair : permettre aux territoires de produire leur propre énergie.
“Les projets sont des lieux de coopérations très concrets. Ils créent des compétences locales et une souveraineté énergétique de proximité.”
Eugénie Ponthier est revenue sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur les écoles d’Épinay-sur-Seine, fruit d’une coopérative citoyenne. Le projet a rencontré une forte adhésion, car les habitants ont pu suivre, comprendre et financer une partie du dispositif. “Cela redonne du pouvoir d’agir. Les gens voient leur contribution. Ils deviennent acteurs de la transition.”
Gilles Wintrebert a détaillé le programme Énergieculteurs à Paris : 12 installations photovoltaïques sur des toitures publiques, en autoconsommation collective, financées et exploitées par une coopérative citoyenne qui transmettra ensuite les installations à la Ville.
Ce modèle démontre comment une collectivité peut transformer ses bâtiments publics en ressources énergétiques locales.
Municipales 2026 : Intégrer l’innovation sociale dans les programmes
Intervenants :
- Mohamed Gnabaly, Maire de L’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Président de l’association départementale des Maires de Seine-Saint-Denis
- Sébastien Sellier, Directeur du développement, Signes de Sens (lauréat 2019)
Dernière séquence de la journée, ce dialogue a replacé l’innovation sociale au cœur du débat politique à venir. Comment les futurs exécutifs municipaux peuvent-ils intégrer ces démarches dans leurs programmes ?
Pour Sébastien Sellier, l’enjeu est d’abord méthodologique :
“Nous devons codévelopper et cocréer. Collectivités et associations travaillent pour les mêmes bénéficiaires. Il est logique qu’ils conçoivent ensemble les solutions.”
Mohamed Gnabaly a apporté l’exemple emblématique de L’Île-Saint-Denis, où l’ESS structure une part significative du développement économique local. Sur 77 hectares, la commune accueille 12 tiers-lieux, 30 acteurs de l’ESS et plusieurs entreprises devenues des références nationales.
Il a décrit un modèle fondé sur des “boucles vertueuses” : restauration collective municipale 100 % bio, gestion des déchets alimentaires par Les Alchimistes, compost utilisé par Fleurs d’Halage, fleurs rachetées par la commune pour ses cérémonies.
Il a également rappelé un point décisif souvent sous-estimé :
“Le partenariat entre acteurs de l’ESS et un exécutif local ne doit pas se concevoir sur un an, dans le cadre d’un marché, mais se penser sur la durée, à l’échelle de tout un mandat, sur six ans, si l’on veut produire des changements véritables et pérennes.”
Cette vision s’inscrit dans sa conception d’une ESS pleinement arrimée au projet municipal : “L’ESS, ce n’est pas un secteur. C’est le prolongement de l’action municipale. Ce sont des partenaires, pas des prestataires.”
Cette table ronde a montré que l’innovation sociale peut constituer l’ossature d’un programme municipal ambitieux, en renforçant à la fois la résilience locale, la cohésion sociale et l’impact environnemental.
Appel à engagement : Faire de l’innovation sociale un pilier des politiques locales
En conclusion, Damien Baldin et Enora Hamon ont rappelé l’essentiel : l’innovation sociale est née du terrain ; elle y demeure et s’y déploie.
La France s’engage se positionne comme un facilitateur, un accélérateur, un tiers de confiance au service des collectivités et des initiatives locales.
L’ensemble des débats a démontré que, sur des sujets aussi variés que la petite enfance, la ruralité, la transition écologique ou la revitalisation commerciale, les solutions existent, sont éprouvées, et peuvent être reprises par toutes les communes.
À l’heure des municipales 2026, la journée a envoyé un message clair : intégrer l’innovation sociale dans les politiques locales n’est plus un choix périphérique, mais un levier central pour bâtir des territoires solidaires, dynamiques et durables.