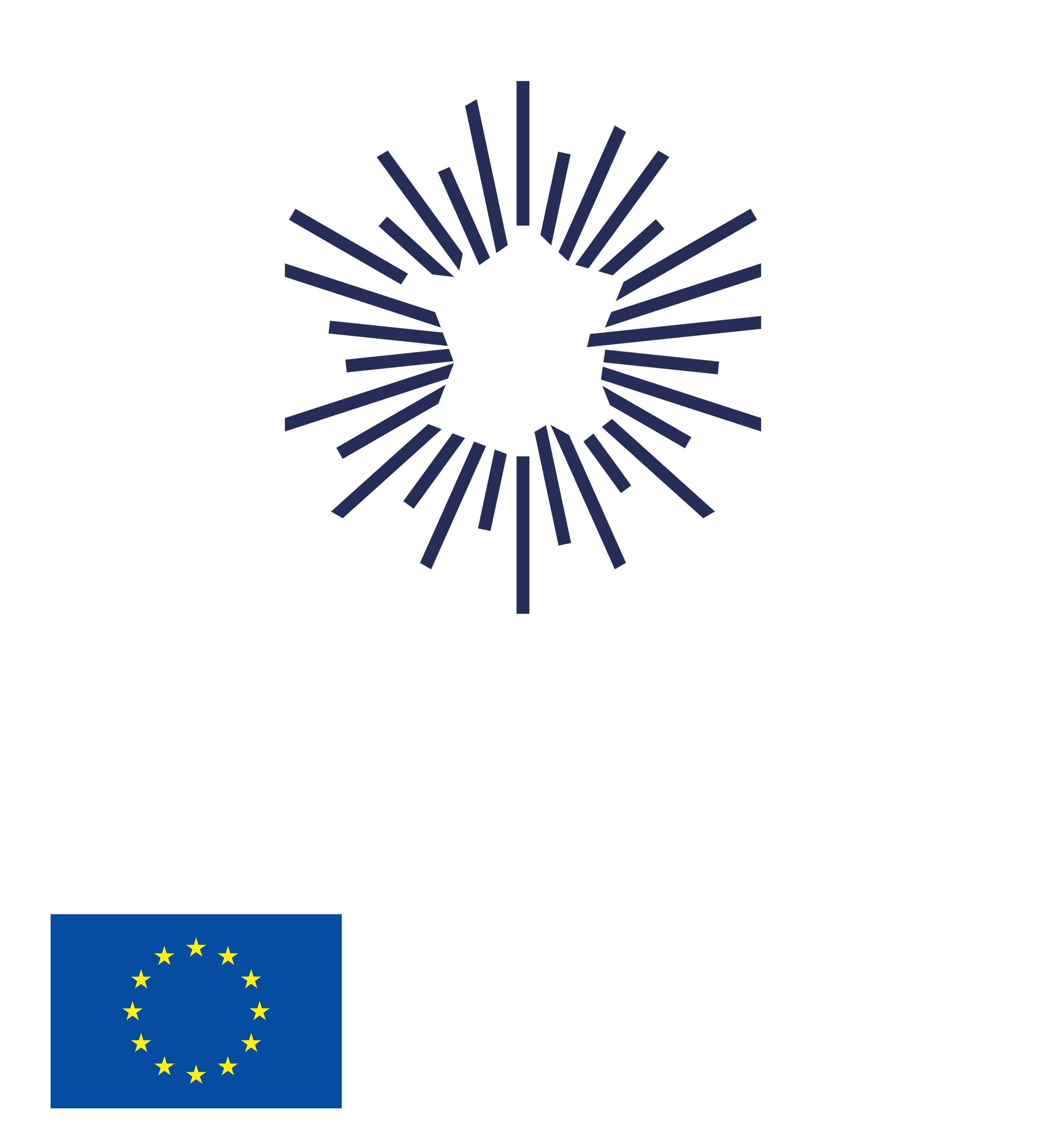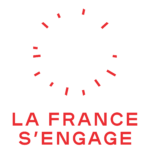WEBINAIRE – Comment structurer une stratégie de changement d’échelle ?

Dans le secteur de l’innovation sociale, la capacité à essaimer un projet, c’est-à-dire à le répliquer dans d’autres territoires sans dénaturer son impact, est devenue une compétence-clé. Face à des besoins sociaux urgents et différenciés, les organisations de l’économie sociale et solidaire sont de plus en plus nombreuses à vouloir changer d’échelle. Mais encore faut-il savoir comment.
C’est pour répondre à cette exigence stratégique que La France s’engage a récemment proposé à ses lauréats et alumni un webinaire de formation sur les stratégies d’essaimage, conçu et animé par ScaleChanger, expert de l’accompagnement au changement d’échelle dans l’ESS.
Pourquoi professionnaliser sa stratégie d’essaimage ?
L’essaimage, dans le cadre d’un projet d’utilité sociale, ne se réduit pas à une duplication de dispositifs. Il s’agit d’une transformation en profondeur du modèle d’action, qui peut être à la fois juridique, organisationnelle, financière et politique. L’objectif n’est pas seulement de croître : il est de rendre une innovation sociale réplicable, de manière rigoureuse, pérenne et contextualisée.
Pour La France s’engage, l’essaimage constitue l’un des piliers du passage à l’échelle. Il permet de faire des projets lauréats des solutions d’intérêt général transposables, capables d’alimenter les politiques publiques, de renforcer les réponses apportées par les collectivités locales ou encore d’être adoptés par d’autres porteurs de projets dans de nouveaux territoires.
Quels sont les modèles d’essaimage existants ?
La formation proposée distingue clairement plusieurs modèles d’essaimage, chacun répondant à des finalités et contraintes spécifiques. Cette cartographie des modes d’essaimage constitue un socle de réflexion indispensable.
- L’essaimage centralisé : la structure pilote reproduit elle-même son action sur un nouveau territoire, en gardant le plein contrôle.
- La franchise sociale : modèle contractuel avec un haut niveau d’exigence, qui consiste à transférer fidèlement son modèle à des acteurs locaux indépendants
- L’essaimage souple : le portage est délégué à des structures locales, avec un cadre partagé (valeurs, méthode, marque) et néanmoins d’importantes marges d’adaptation
- La fertilisation (ou dissémination) : le savoir-faire est mis à disposition, de manière plus ou moins libre, sans animation de réseau ni suivi structuré.
Cette typologie permet aux organisations de choisir un ou plusieurs modèles d’essaimage adapté à leur degré de maturité, à leur capacité de pilotage, et à la nature de leur impact.
Définir un modèle à transmettre : quelles étapes clés ?
L’un des principaux apports du webinaire a été d’amener les porteurs de projets à répondre à une question fondatrice : que souhaite-t-on essaimer ?
Un outil méthodologique puissant a été présenté : la grille d’essaimage, qui permet d’identifier les éléments fondamentaux d’un projet, ses marges d’adaptation, et ses conditions de transposition.
Parmi les éléments à clarifier :
- Les publics cibles à atteindre dans les nouveaux territoires
- Les activités clés du projet (ce qui doit être impérativement reproduit)
- Le périmètre géographique pertinent (commune, département, région, académie)
- L’organisation locale minimale (équipes, profils, gouvernance)
- Le modèle économique de l’essaimage (quelle part de financement local ?)
- Les partenaires structurants (collectivités, ARS, universités, etc.)
Ce travail de modélisation permet de construire une stratégie d’essaimage réaliste, structurée et communicable.
L’exemple de Nightline France : un essaimage maîtrisé au service de la santé mentale
L’intervention de Julianne Matiussi., déléguée générale adjointe de Nightline France, a constitué un temps fort de la formation.
L’association, engagée pour la santé mentale des jeunes, a choisi une stratégie d’essaimage centralisée, permettant une homogénéité forte dans les processus, les formations et les outils déployés. Ce choix répond aux exigences du domaine d’action, où la qualité et la sécurité des pratiques ne peuvent être compromises.
Nightline a ainsi développé un modèle d’essaimage progressif, structuré autour :
- d’un socle commun (ligne d’écoute, actions de proximité),
- de délégué·es territoriaux salariés, animant le lien avec les partenaires et les bénévoles,
- d’un pilotage régional intermédiaire (directrices de régions),
- d’un budget mixte (50 % local, 50 % national).
Le retour d’expérience met en lumière les tensions fécondes entre homogénéité nationale et adaptation locale, entre structuration et agilité. Il montre aussi l’importance de l’anticipation RH, du pilotage budgétaire et de la co-construction avec les bénévoles.
Outils d’aide à la décision : le parcours d’essaimage
Autre outil phare de la formation : la formalisation du parcours d’essaimage. Il s’agit ici de découper le processus de déploiement en étapes claires, de les articuler avec les responsabilités de chaque échelon (local/national), et de les associer à des outils, des critères de passage, des charges en jours-homme.
Ce type de projection permet d’évaluer la faisabilité organisationnelle et financière d’un essaimage. Il alimente également les réflexions sur la gouvernance, la montée en compétence des équipes, et le dimensionnement du siège.
Une démarche structurante, portée par un partenariat d’expertise
Parce que le passage à l’échelle ne s’improvise pas, La France s’engage s’appuie, dans la durée, sur des partenaires spécialisés capables d’apporter aux porteurs de projets des méthodes, des repères et un regard stratégique. C’est le cas de ScaleChanger, partenaire de l’accompagnement sur les enjeux d’essaimage, qui intervient aux côtés des lauréats à la fois à travers des formations collectives, comme ce webinaire, et des missions d’accompagnement individuel, ciblées selon le stade de développement de chaque organisation.
Avec plus de dix années d’expérience dans l’accompagnement au changement d’échelle des innovations sociales et environnementales, ScaleChanger apporte une expertise reconnue, nourrie par des dizaines de cas concrets, dans des contextes d’action très différenciés. Leur approche, à la fois structurante et pragmatique, permet aux porteurs de projets de consolider leur stratégie d’essaimage, d’interroger leur modèle économique, de clarifier leurs objectifs, et de formuler des choix organisationnels cohérents avec leur vision.
Dans ce cadre, La France s’engage ne cherche pas à imposer une trajectoire-type, mais à créer les conditions d’un dialogue exigeant entre porteurs de solutions et experts de la structuration. Ce sont ces passerelles entre engagement de terrain et cadre stratégique qui permettent aux innovations sociales de devenir des leviers systémiques.