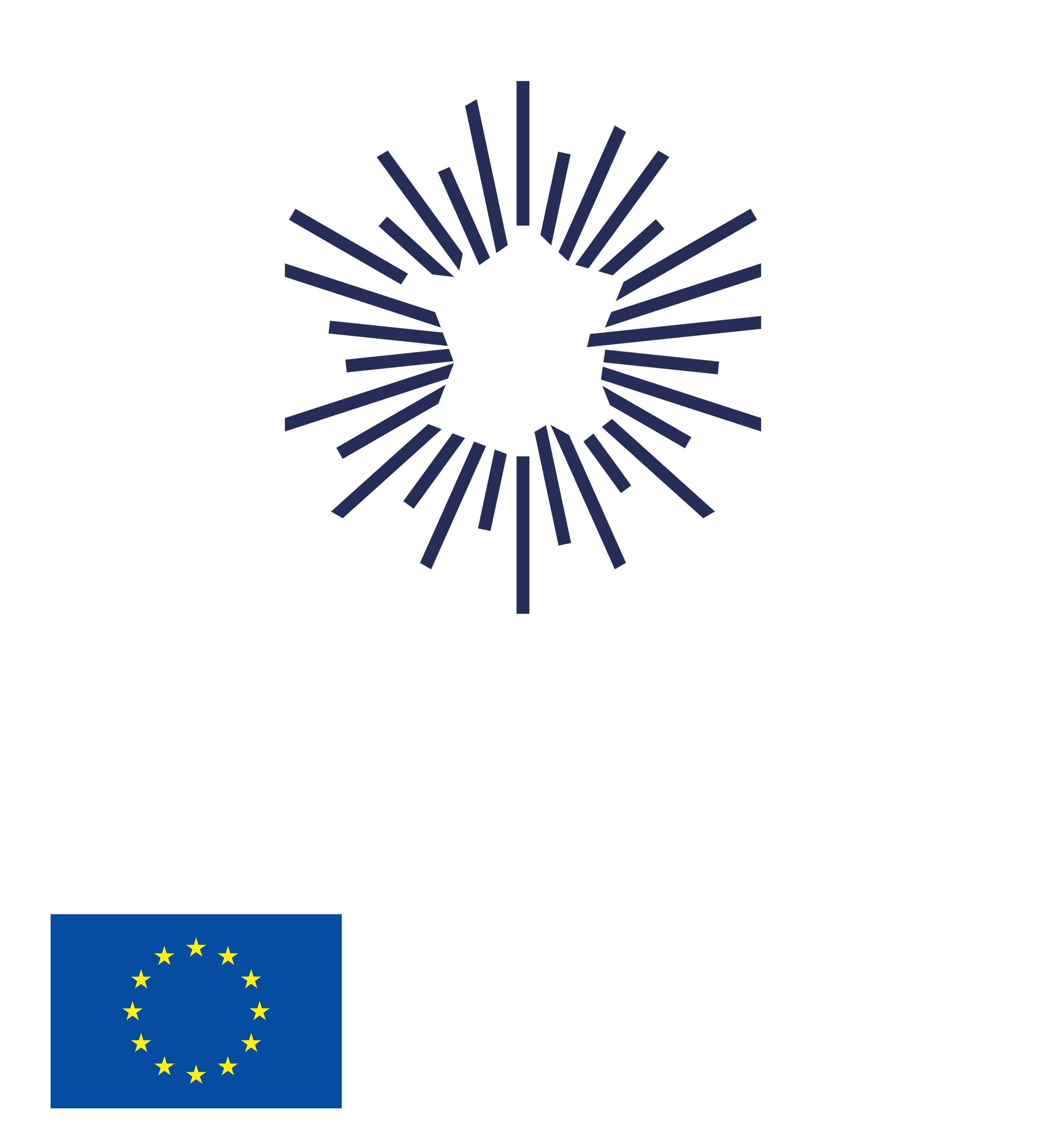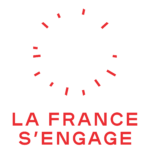WEBINAIRE – Faire porter sa voix dans son écosystème : formation stratégique au plaidoyer

Comment une organisation peut-elle émerger dans son écosystème et incarner une parole légitime sur sa cause ?
Cette question, longtemps reléguée à la marge, s’impose aujourd’hui comme centrale pour les organisations à impact. Dans un contexte d’érosion de la confiance dans les institutions, de complexification des chaînes de décision publique et de saturation médiatique, faire entendre sa voix nécessite bien plus qu’une bonne intention : cela exige une stratégie, une méthode, une capacité à transformer un engagement de terrain en influence effective.
C’est dans cette optique que La France s’engage a organisé, à destination de ses lauréats et alumni, une formation au plaidoyer, conçue comme un temps de professionnalisation. Animée par deux experts, Claire Duizabo et Basile Michardière, partenaires de l’accompagnement, cette session a permis de poser les bases d’un plaidoyer à la fois réaliste, rigoureux et ancré dans les spécificités de l’économie sociale et solidaire.
Le plaidoyer, un levier systémique encore trop peu investi
La formation s’est ouverte sur un constat : le plaidoyer reste encore trop souvent sous-exploité dans les stratégies des organisations de l’ESS. Il est fréquemment perçu comme un exercice de pouvoir réservé aux grandes ONG dotées d’équipes expertes ou aux fédérations sectorielles fortement institutionnalisées. Pourtant, les faits récents montrent une autre réalité : de plus en plus d’acteurs émergents s’en saisissent, avec agilité et pertinence.
Pourquoi ? Parce qu’un plaidoyer structuré permet de changer les règles du jeu, d’agir non seulement sur les symptômes mais sur les causes systémiques des inégalités ou des défaillances sociales. Il devient une extension naturelle de l’action de terrain. Il renforce l’attractivité de l’organisation auprès de ses parties prenantes, ouvre des portes politiques, crédibilise un positionnement d’acteur de référence sur une cause donnée.
Des campagnes visibles comme celles menées par Label Emmaüs sur la fast fashion ou Règles Élémentaires sur la précarité menstruelle illustrent cette montée en puissance d’un plaidoyer décomplexé, tactique et incarné, mené par des structures de taille modeste mais à l’impact tangible.
Quatre ingrédients structurants pour un plaidoyer crédible
La formation a ensuite proposé une méthode pragmatique et éprouvée, articulée autour de quatre piliers. Ces ingrédients, loin d’être théoriques, ont été illustrés par des cas concrets issus du réseau des lauréats ou du champ élargi de l’ESS.
-
Formuler une ambition claire et déclinable
Tout commence par une ambition : quelle transformation sociale ou environnementale souhaitez-vous provoquer ? Il ne s’agit pas d’un simple slogan ou d’une vision abstraite, mais d’une projection politique articulée à des revendications précises. L’approche proposée s’appuie sur une logique descendante : de la vision à 10 ans jusqu’à des objectifs opérationnels atteignables dans les 18 à 24 mois.
Les exemples de Simplon ou Weavers ont montré comment une vision forte – l’accès de tous aux métiers numériques pour l’un, l’insertion durable de personnes exilées pour l’autre – peut se traduire en revendications claires, argumentées par des données solides et ancrées dans des actions concrètes : tribunes, rencontres institutionnelles, campagnes numériques.
La notion de victoires intermédiaires a été soulignée comme essentielle : il ne s’agit pas de tout transformer d’un seul coup, mais de segmenter les objectifs pour rendre visible la progression et consolider l’énergie collective. L’atteinte d’une réunion stratégique, l’obtention d’une mention dans un rapport parlementaire, la publication d’un livre blanc sont autant de jalons.
-
Structurer une organisation interne dédiée
Un plaidoyer n’est pas seulement une prise de position, c’est une dynamique collective. Cette deuxième séquence a mis en lumière l’importance d’organiser en interne les conditions de sa durabilité et de son efficacité. Qui porte la parole ? Quelle articulation avec la communication ? Quelle gouvernance ? Quels relais dans l’équipe et le CA ?
Les consultants ont proposé plusieurs modèles types : un binôme entre direction générale et référent plaidoyer ; une “task force” transversale associant salariés et membres du conseil ; ou encore un dispositif distribué selon les publics cibles (scientifique, politique, médiatique). L’idée forte : institutionnaliser le plaidoyer sans le bureaucratiser.
Cette structuration passe aussi par un mandat explicite : le plaidoyer ne peut pas être l’initiative discrétionnaire d’un.e salarié.e ou d’un.e fondateur.rice. Il doit faire l’objet d’un consensus, d’une validation stratégique, voire d’un vote en conseil d’administration, pour éviter les retournements de position ou les frictions internes.
-
Produire des preuves de légitimité
Une parole est d’autant plus audible qu’elle repose sur des preuves solides. Ici, il s’agissait de doter les participants d’un répertoire de formats et d’outils pour renforcer leur légitimité dans l’espace public. Rapports d’impact, baromètres, livres blancs, tribunes collectives, mesures de coût-efficacité… autant de supports qui transforment l’expérience de terrain en arguments recevables par les décideurs.
Le point saillant : ces productions ne doivent pas rester dans des placards numériques. Elles doivent être éditorialisées, rendues intelligibles, segmentées selon les cibles. La diffusion compte autant que la production. Le baromètre de la Fraternité ou les études de Refugies.info en sont des exemples frappants de rigueur méthodologique et de force de frappe médiatique.
Les intervenants ont insisté sur l’intérêt de s’associer à des partenaires crédibles (instituts de sondage, think tanks, universités, cabinets d’étude) pour renforcer l’effet “tampon” et éviter l’autocitation. Ce sont ces preuves qui permettent de faire autorité, d’ancrer un positionnement de leader d’opinion.
-
Nouer des alliances pour peser davantage
Le dernier levier est sans doute le plus structurant : la mise en réseau et la construction de coalitions. Un plaidoyer isolé est rarement influent. En revanche, une parole portée par plusieurs structures, incarnée dans des espaces de dialogue et d’action, devient un levier puissant de transformation.
La formation a détaillé les étapes clés d’une telle stratégie : cartographier son écosystème, identifier les alliés naturels ou “co-compétiteurs”, créer des alliances asymétriques (entre petits et grands), mutualiser les moyens, diversifier les postures. Les coalitions permettent de varier les canaux, de partager les risques et d’étendre le spectre d’influence sans diluer les singularités.
Le plaidoyer devient ainsi un exercice de diplomatie horizontale, où l’on construit des convergences sans rechercher l’unanimité, en acceptant la pluralité des récits. À terme, cette capacité de coalition est aussi un atout stratégique pour le changement d’échelle, la co-construction avec les pouvoirs publics ou les réponses aux appels à projets collectifs.
Le plaidoyer comme investissement d’avenir pour les structures de l’ESS
En conclusion, cette session a permis de lever les freins, de nommer les défis, mais surtout d’outiller concrètement les lauréats pour inscrire le plaidoyer dans leur stratégie organisationnelle. Oui, le plaidoyer demande du temps, de la méthode, des ressources – souvent rares. Mais il constitue un investissement structurant pour la visibilité, la légitimité et l’impact des organisations à finalité sociale.
La France s’engage, en faisant de cette compétence un axe de formation, affirme un positionnement clair : soutenir non seulement les solutions, mais aussi ceux qui savent les faire reconnaître, adopter, diffuser à l’échelle. C’est là une manière forte d’accompagner la transformation systémique que promeut la Fondation.
📌 À retenir :
- Le plaidoyer est une démarche stratégique et structurée, à ne pas confondre avec une simple communication d’opinion.
- Il repose sur une articulation entre vision, revendications concrètes, preuves tangibles et alliances stratégiques.
- La France s’engage outille ses lauréats pour faire du plaidoyer un levier d’impact politique, social et culturel durable.