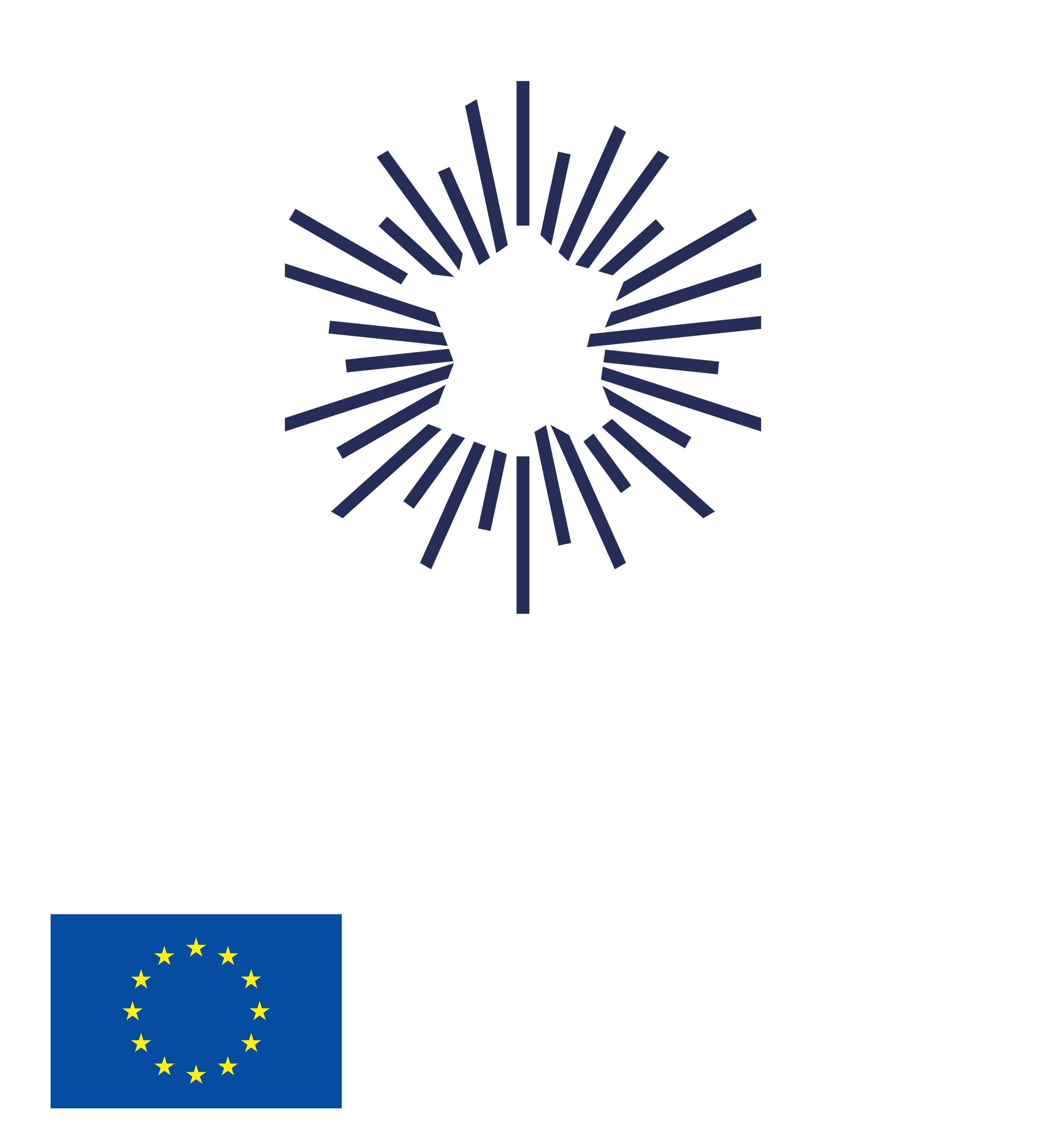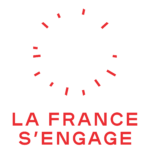WEBINAIRE – Compétences psychosociales : pourquoi et comment en mesurer l’impact ?

À l’heure où la notion d’impact social structure les stratégies des acteurs de l’intérêt général, les compétences psychosociales (CPS) émergent comme un levier déterminant dans la construction de trajectoires éducatives, professionnelles et citoyennes durables. Pourtant, leur évaluation rigoureuse reste encore peu maîtrisée, souvent reléguée au second plan, éclipsée par des indicateurs plus tangibles mais moins décisifs.
Pour éclairer ces enjeux, Quentin Daviot, économiste et fondateur d’Eval-Lab, a conduit un webinaire à destination des lauréats et alumni de La France s’engage, sur les fondements scientifiques et méthodologiques de l’évaluation des compétences psychosociales, et leur importance stratégique pour les structures qui les développent.
Pourquoi les compétences psychosociales sont-elles décisives ?
Derrière ce terme encore flou se loge une constellation de savoir-être : estime de soi, persévérance, capacité à coopérer, résilience, conscience de soi et des autres, etc. Toutes ces compétences ont en commun d’être peu corrélées au QI mais fortement prédictives de l’insertion sociale et professionnelle.
Les travaux cités au fil du webinaire sont sans appel : à niveau scolaire égal, ce sont ces compétences qui font la différence, notamment pour les jeunes issus de milieux populaires. En France, les études PISA comme les travaux de sociologie empirique attestent d’un déficit massif et transversal de CPS, affectant toute la population, mais particulièrement aigu chez les filles et les publics les plus fragilisés.
Mesurer ce qui compte : rigueur méthodologique et exigences scientifiques
Evaluer l’impact d’un programme d’accompagnement ou d’éducation aux CPS suppose plus qu’un simple suivi déclaratif. L’objectif est d’isoler un effet causal : ce que les bénéficiaires sont devenus grâce au programme, comparé à ce qu’ils seraient devenus sans.
Quentin Daviot a rappelé la différence cruciale entre corrélation et causalité. Un progrès observé chez les bénéficiaires ne prouve pas en soi l’efficacité du programme : il peut résulter d’une évolution naturelle ou d’un autre facteur. Toute la difficulté consiste donc à construire un groupe de comparaison crédible, dans des conditions éthiques et robustes, pour évaluer avec justesse l’effet réel d’une intervention.
Des preuves fortes : trois évaluations rigoureuses
Trois études internationales rigoureuses, présentées dans le webinaire, démontrent la portée transformative des CPS :
- À Montréal, un programme de développement des CPS chez des garçons à risque (7-9 ans) montre, 20 ans plus tard, des effets très significatifs sur les diplômes, l’employabilité, les revenus et le recours aux aides sociales. Investir 1 dollar dans ce programme en rapporte 11 à long terme.
- En France, une adaptation du Kindness Curriculum pour des élèves de maternelle (3-5 ans) a permis une amélioration nette du bien-être émotionnel et de la relation avec les enseignants, en particulier chez les enfants en grande difficulté comportementale.
- Aux États-Unis, une simple série d’exercices d’écriture sur les valeurs personnelles a permis à des lycéens de renforcer leur estime d’eux-mêmes, avec un effet direct sur leurs résultats scolaires.
Ces études montrent que l’impact est possible à tous les âges, pourvu que les programmes soient conçus avec finesse et mis en œuvre avec rigueur.
Développer un impact réel : ne pas confondre action et effet
L’une des grandes vertus de cette formation fut de rappeler que mettre en œuvre un programme n’implique pas automatiquement un impact. Le type d’intervention (coaching, formation, mentorat…) compte, mais la conception et le ciblage des bénéficiaires sont encore plus déterminants.
Des études montrent par exemple que le profil des bénéficiaires peut influencer sur le potentiel d’impact d’un programme. Des programmes qui ciblent des publics déjà les plus proches de la réussite peuvent avoir un potentiel d’impact faible
Vers une culture d’impact plus mature
Le webinaire s’est conclu par un plaidoyer pour une culture de l’impact plus exigeante, plus honnête, moins performative. Il ne s’agit pas de produire des chiffres à tout prix, mais de documenter sérieusement ce qui fonctionne, pour qui, dans quelles conditions, et à quel coût.
Ce type de prise de recul, rare dans l’écosystème de l’ESS, est précieux pour toutes les structures qui souhaitent à la fois convaincre leurs partenaires, ajuster leurs actions et peser durablement sur les politiques publiques.
A travers ces formations, La France s’engage donne aux structures qu’elle soutient les outils de leur autonomie intellectuelle. Ce n’est pas tant l’évaluation qui est au cœur de cette démarche que la capacité à penser l’action dans son efficacité réelle, et à dialoguer d’égal à égal avec les décideurs, les financeurs, les chercheurs.
Dans un écosystème où les mots « impact » et « évaluation » sont souvent galvaudés, cette séance a fait œuvre de clarification, en replaçant les compétences psychosociales là où elles devraient toujours être : au cœur des trajectoires de vie, des politiques éducatives et des projets sociaux.